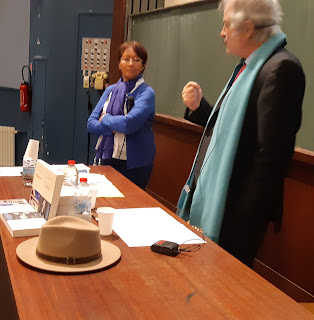Observatoire des médias – 17 décembre 2021
Compte rendu de la conférence débat
de Romain Badouard
Modération et censure sur le Web
Présentation : Patrice Saint André

photo JC2
Internet né aux Etats Unis a été conçu comme un outil de la
liberté d’expression. La liberté d’expression est centrale dans la culture
américaine à travers notamment le 1er amendement de la constitution
qui précise que l’Etat doit être extérieur au libre marché des idées. C’est un modèle politique différent de la
culture française où très tôt le législateur a voulu réguler la liberté
d’expression en particulier par la loi
de 1881 sur la liberté de la presse et ses compléments ultérieurs qui ont
notamment introduit les notions de
discrimination, d’injure ou de diffamation. Le nouveau contexte créé par Internet est
apparu en 1996 en France lors de l’interdiction du livre du médecin de François
Mitterrand. Le livre a été repris via un cyber café de Besançon par des sites
accessibles à l’étranger permettant ainsi de contourner l’interdiction.
L’apparition et le développement des réseaux sociaux et les
excès qu’ils provoquent n’ont fait qu’accentuer la demande de régulation du Web
particulièrement au regard des incitations à la haine et au harcèlement. Mais
qui est responsable d’un propos sur Internet, le « plombier »
ou hébergeur qui fournit les réseaux et le support, ou l’éditeur, auteur du
message ? Les réseaux sociaux ont bouleversé les choses sur le plan
juridique et le « filtrage » par les plates formes s’est
progressivement accru.
La recentralisation du Web s’est notamment manifestée par la
censure imposée à Donald Trump lors de l’invasion du Capitole le jour de la
prestation de serment de Jo Biden, ou
l’invisibilisation de certains réseaux féministes ou, la
disparition, pour les Chinois, des massacres de la place Tien’ Anmen. Les
publicateurs élaborent des standards de publication qui, dans un premier temps,
ont imposé la pudibonderie américaine à toute la toile. Les règles ont évolué
progressivement en fonction des pays et des cultures locales.
Concrètement les plates formes interviennent :
-
Par les signalements des internautes, qui
suscitent la réaction de « censeurs » souvent installés dans les pays
du Sud. Leur mission est de décider « en
2 secondes » ce qui doit être publié ou non. Les risques de
manipulation ou de signalement abusifs sont évidents. La matière est d’un
volume considérable (Youtube, c’est 500 heures de vidéos à la minute…).
-
Utilisation de l’intelligence artificielle.
S’avère efficace pour détecter des images (nudité). La détection à partir des
mots est plus incertaine, le sens pouvant être très différent selon le contexte
et selon les codes utilisés par des minorités (cf.88 pour les pro-nazis). Par
ailleurs, l’intelligence artificielle ne connait pas l’ironie…
-
Les plates formes peuvent aussi « invisibiliser »
ou dégrader considérablement les contenus ou les émetteurs « nocifs ».
Quel rôle pour les
Etats ? L’intervention se concrétise sous plusieurs formes.
-
Les menaces d’amende comme dans la loi Avia du
24 juin 2020. Des interventions en principe rapides (24 ou 48 h) et des sanctions lourdes,
jusqu’à 4% du chiffre d’affaires . La loi a été largement réformée par le
Conseil Constitutionnel.
-
La recherche de la transparence sur les
modalités de contrôle, en d’autres termes lutter contre l’opacité stratégique.
-
Au plan européen, la mise en place du Digital
Service Act qui vise à développer des audits indépendants. Tout ce qui est interdit dans l'espace public
sera aussi interdit dans l’espace online.
Enfin, l’intervention de la justice reste encore à inventer,
ainsi que la gouvernance démocratique des contenus où les internautes doivent
trouver leur place.
Jean-Claude Charrier- Décembre 2021
Le livre de Romain Badouard Les nouvelles lois du Web ; Modération et censure – Seuil La
République des idées 2020
L'intégralité de la conférence sur la Web télé de l'université de NantesLibellés : censure, Jean Claude Charrier, Modération, OMUP ( Observatoire des médias UP), Patrice Saint André, Romain Badouard, Web